jeudi, 21 décembre 2017
Le logique et les tiques…
Mon père, qui n’était pas un ange, était tout de même quelqu’un de plutôt gentil et patient.
Évidemment, quand on lui marchait sur les pieds, il faisait preuve d’un sens de l’humour qui ne plaisait pas toujours.
Mais il pouvait, quand on le gonflait trop, se montrer particulièrement féroce.
S’il n’aimait pas les gens, il était « mi-figue mi-raisin » mais si l’occasion se présentait d’un « mot », il ne pouvait s’empêcher de l’ouvrir.
Il est heureux qu’il ait eu plutôt un caractère à aimer les gens qu’à les détester sinon il serait probablement mort des décennies plus tôt.
En une occasion, comme ça, il réussit à faire honte à ma mère et à se débarrasser d’une dame qui passait à la maison voir ma mère et dont il supportait mal la présence.
Il accueillait volontiers notre voisin et sa femme.
Le voisin passait le soir pour lui jouer une scène courante dans les étages de l’immeuble.
- Dis donc, Gaby, t’aurais pas une …
- Je sais, t’as oublié les tiennes dans ton placard au travail…
- Comment tu sais ?
- Bon, deux « Balto », ça te va ?
- Une seule !
- Et celle d’après dîner ?
- Bon... Je te rends ça…
- Je sais, samedi soir…
De même, mes parents étaient content d’avoir à table « Monsieur Seuillet » et sa femme.
Même si ma mère devait surveiller mon père qui restait en costume pour le repas.
Hélas, mon père ne supportait pas Madame C.
Personne ne connaissait « Monsieur C. » jusqu’au jour où ma mère invita Monsieur et Madame C. à déjeuner un dimanche midi.
J’avais vu plusieurs fois Madame C.
C’était une dame plus que corpulente, soufflant à chaque pas et débordant de tous ses habits et trouvant à redire sur à peu près tout ce qu’elle voyait dans la maison.
Je ne sais pas pourquoi ma mère la voyait régulièrement et aujourd’hui je me demande si elle n’avait pas souhaité que mon père l’en débarrasse…
« Lemmy » avait beau faire preuve de patience pour faire plaisir à « Ma poule », il y eut Madame C. une fois de trop.
Ce dimanche là, ils frappèrent à la porte.
Ma mère se précipita et ouvrit.
Elle revint dans « la grande pièce » suivie de Monsieur et Madame C.
Elle formait avec Monsieur C. un couple genre « Hercule et Doucette ».
Ma mère les présenta à mon père.
- Voilà, Lemmy, Monsieur C. et sa moitié.
Mon père les regarda, resta un moment silencieux et dit à ma mère :
- Tu es sûre de savoir qui est la moitié de l’autre ? »
Madame C. fut scandalisée, lui se tut.
Ils partirent en silence.
« Lemmy » redevint « Gaby » pour plusieurs jours…
Je n’ai jamais revu Madame C.
Pourtant mon père était un vrai gentil, je vous l’assure…
10:45 | Commentaires (12)
mardi, 19 décembre 2017
Aujourd’hui je serai au dessus d’Eloi !
Ce matin je me suis réveillé avec les questions qui tracassent normalement l’honnête homme.
Des questions aussi vieilles que le monde des questions.
Adam avait-il un nombril ?
Comment, alors qu’Eve n’avait eu que des fils, l’humanité est-elle parvenue à être aussi nombreuse ?
Abel tué, Caïn et Seth auraient ils sauté leur maman ?
Les anges avaient ils un sexe ? Si oui, lequel ?
L’arrivée d’autres anges était elle parthénogénétique ou due au câlin ?
Bref, à peine éveillé j’étais déjà occupé de plein de questions étranges.
Et je me suis demandé quoi faire, en dehors des tâches quotidiennes…
Puis d’un coup, sans préavis je me suis fait la réflexion que les smartphones étaient à l’espèce ce que fut en son temps le joueur de flûte de Hamelin.
D’outil utile pour transmettre les nouvelles importantes, il est devenu le magicien qui que vous suivez partout.
Ne riez pas, ce n’est pas lui qui vous suis, c’est vous qui êtes liés à lui, il vous entraîne où il veut, au gré de nouvelles ans importance.
Je me suis dit qu’il n’était pas si mauvais finalement que je l’oublie à la maison et que je ne l’entende que rarement quand, encore plus rarement j’ai pensé à le mettre dans ma poche.
Et puis, je suis assez maladroit, pas la peine que je risque de me retrouver à plat ventre en faisant comme beaucoup de ceux que je croise : Avancer sans voir le monde autour de soi, hypnotisé par ce petit écran plein de choses sans réelle importance…
Je me suis alors dit que si la lumière de mes jours n’a pas oublié la promenade au Sacré Cœur qu’elle avait prévue et qui fut remplacée par l’achat d’un four, on peut tenter le périple.
L’idée de prendre le funiculaire si par hasard il fonctionnait me plaît déjà.
Puis, pour « jouer à Baedecker » on pourrait même faire un chemin à la fois varié et direct pour revenir.
Imaginez, lectrices chéries.
On descend du funiculaire en haut de la butte, une fois les touristes chinois égayés à dépenser leurs sous dans des souvenirs de Montmartre fabriqués à Shenzen, on s’accoude à la rambarde qui domine le jardin.
Avec un soupir d’aise, on se tourne et on regarde Paris un moment.
On trouve ça très beau comme toujours…
On verra le dôme des Invalides plein de dorures, la tour Montparnasse, qui continue à pourrir la perspective.
En tournant la tête vers la gauche, on verra les tours du XIIIème.
Évidemment je regarderai en direction du Marché Saint Pierre et je me dirai « tiens ? La publicité « Duluc détective. Voit tout ! Entend tout ! » a disparu… »
Puis on continuera la rue du cardinal Dubois.
Elle me fait toujours penser à Jean Rochefort qui en tint le rôle dans « Que la fête commence ».
On ira jusqu’à la rue Lamarck.
La rue Lamarck fait le tour de la butte et croise des rues que je ne ferai pas arpenter par Heure-Bleue.
La rue des Saules et la rue du Mont Cenis sont très chouettes mais posent un problème.
Ce sont des escaliers !
Imaginez moi un instant, allant au Sacré Cœur en montant plus de quarante étages !
Et puis Heure-Bleue !
Descendre plus de quarante étages avec ses pieds aux fractures non réduites serait une torture.
Imaginez la butte Montmartre à descendre par des escaliers…
On continuerait donc la rue Lamarck en flânant tranquillement.
Bon, à nos âges on ne s’arrêterait plus sous les porches mais ce serait sympa comme balade.
Je sais qu’on croiserait d’autres rues et même un super boulanger.
Ça sera bien, je suis sûr.
Bon, maintenant que je suis levé, je vais et préparer le petit déjeuner de la lumière de mes jours…
10:36 | Commentaires (18)
lundi, 18 décembre 2017
La palme dort…
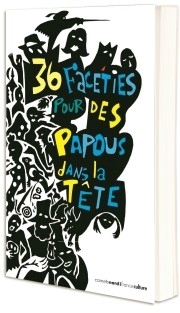
Lakevio nous réclame un petit tas d’effets
C’est là une occasion de boire du petit lait
Et rien n’est plus aisé, surtout rien n’est plus vrai
Que pondre un misérable rimaillon très laid.
Je me sens face à ça un peu trop maigrelet
Du moins du point de vue de mon vieux cervelet
A bien y réfléchir je ne me sens pas frais
Et même si j’osais, je dirais « je suis blet »
Que pourrais-je obtenir de ce petit reflet ?
Je ne peux rien tirer de ce que je dirai
Pas même du public un semblant d’intérêt…
Ça fait de mon récit roupie de sansonnet.
Il manque plus qu’un vers pour qu’il soit un sonnet…
08:29 | Commentaires (21)
dimanche, 17 décembre 2017
Et le verbe s’est fait cher…
De rien, Mab & Lakevio, de rien…
Hier, nous sommes partis pour quelque chose de précis.
Ça ne devait nous prendre que peu de temps.
Il s’agissait de remplacer le four que les déménageurs ont transformé en informe tas de tôle inutile.
Ça ne nous a pris effectivement moins d’une demi-heure et il devrait nous être livré aujourd’hui même.
Je n’aurais jamais pensé que l’avidité commerciale se transformerait aussi rapidement en fibre esclavagiste.
Même la jeune femme absolument charmante qui remplissait son samedi en s’occupant de nous devait revenir aujourd’hui travailler.
J’ai bien peur que d’ici quelques années on soit ramené aux débuts de la Révolution industrielle qui avait vu disparaître les samedis, dimanches et fêtes de l’emploi du temps des travailleurs qui devaient aller au charbon sept jours par semaine…
Quant à nous, nous fûmes sages.
Pas d’arrêt à la FNAC.
Pas de petit pâté de canard en croûte chez Pou.
Pas de ratte du Touquet rue Poncelet.
Pas de Romanée-Conti dans l »Le repaire de Bacchus ».
Pas de Glennrothes 1978 pour commencer.
Par de marc de Gewurztraminer pour finir.
Bon, là je rêvais un peu…
On n’a plus l’âge.
Et pas que l’âge.
Bref, nous étions partis vers quinze heures pour moins d’une heure.
Je ne sais pas comment nous faisons mais il est toujours dix-neuf heures quand nous arrivons à la maison.
Nous musardons, voilà…
Et, entre le petit café pour fêter le nouveau four, la balade jusqu’à l’entrée du boulevard de Courcelles.
La constatation que cette partie du XVIIème est belle mais profondément ennuyeuse nous a occupé un petit moment.
Le 30 est enfin arrivé qui nous a ramené place de Clichy, juste pile pour descendre la rue Damrémont pour faire les courses « normales ».
Oui, hier soir j’ai fait des « keftas » avec de la graine de couscous.
Je n’irai pas jusqu’à dire que « c’est bon comme là-bas, djiiis ! » mais la lumière de mes jours a aimé.
Et c’est bien ça l’essentiel.
Tout à l’heure, Imaginer et Chéri passent à la maison pour goûter.
Bon, au lieu de ça :
Ce sera ça :
11:01 | Commentaires (7)
samedi, 16 décembre 2017
La SNCF a une dent contre nous…
Nous devions aller chez le dentiste jeudi.
Hélas, trois fois hélas, les éléments se sont ligués contre nous.
Le trafic à Saint Lazare était très fortement perturbé et la ligne qui nous conduit chez le dentiste vide de trains.
Apparemment un agent de la SNCF s’était fait baffer par un usager mécontent.
Ce qui est idiot car ça n’a jamais amélioré le trafic, la preuve…
Et puis les bus de notre coin ne marchaient pas trop bien non plus.
Peut-être la solidarité des agents de la fonction publique, allez savoir…
J’ai donc appelé le cabinet du dentiste pour prévenir que nous ne pourrions pas aller à notre rendez-vous.
C’est là qu’une secrétaire à l’accent polonais prononcé m’a appris que notre hidalgo de la ratiche avait porté son dévolu sur la Belgique pour une formation complémentaire de trois ans à l’Université de je ne sais où.
Il serait remplacé par un autre dès janvier.
Un Ivan…
Donc, lectrices chéries, j’ai découvert d’un coup que les Polonais n’envoyaient pas chez nous que des plombiers mais aussi des secrétaires médicales.
Idem que les Russes n’envoyaient pas que des chauffeurs de taxi anciens princes mais aussi des dentistes.
Ayant souvenir d’une praticienne d’Europe de l’Est qui arrachait les dents plus vite que son ombre, je me méfie.
Déjà que cette Serbe ou Croate ou Bulgare, je ne sais plus, du genre « Je cacher hache derrière bureau, pas faire peur client… » m’a privé d’une molaire qu’elle eût pu soigner sans problème.
Je me demande ce matin, tant à avoir mal à la bouche, si pour me détartrer les dents, je ne vais pas me rincer la bouche au Harpic.
Ça me rappelle une couverture de « Hara Kiri », ce « journal bête et méchant » dont le bas de la couverture recommandait « si vous ne pouvez pas l’acheter, volez le ! ».
« Hara Kiri » dont un jour la couverture clama « Harpic supprime la mauvaise haleine qui ne provient pas des dents ! »
08:05 | Commentaires (12)





