mardi, 05 juillet 2016
Le clafoutis aux bigorneaux.
Pourquoi donc Heure-Bleue avait-elle fourché de la langue à propos de bigarreaux l’autre jour ?
Eh bien parce qu’avec les poireaux à un bras il lui était venu une idée de clafoutis.
En habitué des promesses de Gascon, j’avais inconsidérément promis à ma moins ardente et plus du tout houri de lui faire…
Un clafoutis.
Elle a vu, place de la Bourse, un marché qui n’est plus des valeurs et dont la corbeille regorge de fruits et non d’actions.
Et sur ce marché des cerises.
- Minou ! Tu m’as dis que tu me ferais un clafoutis !
- Ahem…
Ai-je dit « faux-derchement » tout en demandant au marchand des cerises.
Heure-Bleue a ajouté :
- Une livre, s’il vous plaît.
Puis
- C’est pour me faire un clafoutis !
Sans doute pour faire fondre sur moi l’opprobre qui sied au mec malhonnête au cas où je ne m’exécuterais pas dès le lendemain matin.
Le marchand, très marchand a dit :
- Prenez plutôt celles là, mettez les au frigo car elle sont très bonnes mais assez mûres.
Il a pesé, fait une remise de 70% et ajouté une énorme poignée de cerises après avoir imprimé le ticket.
J’ai goûté les cerises, elles étaient délicieuses.
C’est en revenant à la maison qu’Heure-Bleue m’a dit :
- Ma marque préférée, c’est les « bigorneaux » elle sont moins sucrées…
Je me suis attelé dès potron-minet, c’est à dire vers onze heures car le potron-minet du retraité n’est pas celui de l’éboueur, à ce clafoutis.
Le plus exceptionnel de l’affaire c’est que j’ai réussi à dénoyauter plus d’une livre de cerises sans m’envoyer une seule goutte de jus de cerise sur ma chemise bleu clair.
Et puis j’ai fait ce clafoutis.
Aux dires même de ma moitié « c’était une tuerie ».
Le problème, comme dans toutes les choses censément bonnes pour nous, ce sont les effets secondaires voire pervers.
Ce clafoutis, riche de plus d’une livre de cerises bien mûres dénoyautées, de deux œufs auxquels furent ajoutés deux jaunes d’œuf, de vanille, de sucre, un quart de litre de lait entier et d’une giclée de rhum aurait été parfait pour la famille entière.
Notre famille est composée d’une belle-mère, une mère, un père, un fils, une belle-fille, Merveille et P’tite Sœur, tout ce monde doté d’un appétit de Biafrais de 1968.
Hélas, trois fois hélas, nous n’étions que deux.
Nous avons tenté d’être raisonnables, ça n’a pas marché.
A peine un peu au début.
- Juste un petit bout, Minou, s’il te plaît…
- J’en prends un aussi.
Habituellement je ne prends pas de dessert mais là…
De petit bout en petite part et de petite part en petit morceau et « on va pas laisser ça quand même il n’en reste qu’une part on partage », le clafoutis fut englouti.
Début de la dégustation à douze heures trente.
Lavage de la tôle à quatorze heures trente.
Entre les deux, environ treize cents grammes de gâteau ont disparu.
Assez étonnamment, la balance, contrairement à nous, est restée sage.
On en a déduit que le clafoutis est super diététique.
Je me suis préparé sans le vouloir des matinées industrieuses…
11:09 | Commentaires (11)
lundi, 04 juillet 2016
Heureusement qu'on va vers l'été...
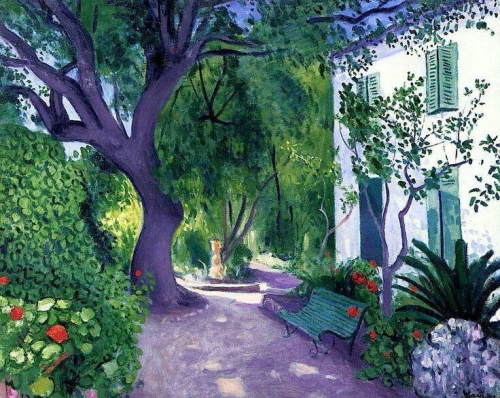
Je vais succomber à une tentation à la quelle je ne succombe que rarement : Celle du recyclage.
Pourquoi ça, lectrices chéries ?
Eh bien parce que le devoir de Lakevio correspond si bien à quelques périodes déjà vécues que je ne résiste pas à l’envie de vous faire part de ce qui m’advint l’été 1957.
Et puis c’est le Tour de France qui m’a ramené là, alors...
Que je vous dise, cette année là, j’ai failli apprendre quelque chose qui devait me servir toute la vie.
Ce fut hélas raté :
Rappelez vous lectrices chéries qui ont déjà lu ce drame enfantin.
« le Goût, laissé estourbi par un coup de foudre contrarié, lors de l’épisode précédent.
Malgré cet échec cuisant, ma détermination n’était pas entamée.
L’opiniâtreté étant la marque de fabrique du Goût-des-autres, je n’allais pas me laisser sombrer sans rien faire pour arranger les choses avec Brigitte P.
Les cris poussés par les parents d’Arlette lors d’explication de gravure avec la sœur n’étaient pas infondés.
Un autre « vieux » habitait à côté de l’infâme fils de flic.
Jacques S.
Il avait treize ans je crois et était aussi passionné par le Tour de France que par la grande sœur d’Arlette sur laquelle il semblait savoir un tas de choses que normalement on ne sait pas à son âge...
Un après-midi de juillet de cette année là j’allai chez lui et demandai à Jacques S. s’il avait une idée pour approcher Brigitte P.
Obnubilé par le Tour, il me jeta « chut » pour écouter l’arrivée de l’étape.
Et là, ça me revient, je sais que j’avais huit ans et qu’on était à l’été 1957 car ce Tour de France fut remporté par Anquetil.
Après avoir pesté car son favori était Darrigade, il m’écouta enfin.
- Mais qu’est-ce que t’y veux à la Brigitte ?
- Ben, euh… qu’elle soit ma « bonne amie » !
- Aaaahh… Tu veux yi (prononcer comme la finale de « bouillie ») faire un p’tit ! Ben t’as qu’à la « quiner » !
Après avoir traîné dans le coin en shootant dans une boîte de pilchards –impeccable pour faire des passoires pour sasser le sable, suffisait d’un clou et d’une pierre-, en jetant des cailloux dans le canal et en me creusant la cervelle, je revins au bistrot de ma tante.
- Dis, ma tante, c’est quoi « quiner » ?
D’habitude elle n’écoutait que d’une oreille distraite le babil de ma petite sœur et moi mais là elle se retourna d’un coup.
« Toi, t’as été voir le Simonot ! » me dit-elle d’un air bizarre, à la fois sévère et vaguement souriant.
Elle parlait avec l’accent de Colette (je ne l’ai su que bien plus tard).
- Oui ma tante, mais qu’est-ce que c’est « quiner » ?
- Tu le sauras bien assez tôt mon « paul’ petit » et crois-moi, quand ça arrivera, tu n’auras pas besoin d’explication…
C’est tout que j’ai appris cette année là.
Et toujours pas de Brigitte… »
06:40 | Commentaires (13)
dimanche, 03 juillet 2016
« Ah ! Ce temps en Rhéa… » disait Chronos…
De rien Mab, de rien…
Que je vous conte avec l’onction milkyenne, une courte aventure, lectrices chéries…
Peut-être vous rappelez vous qu’il y a quelques années on m’a retiré une pièce qui se révéla pour le coup une vraie pièce détachée.
Bilan, au lieu d’avoir un creux, je me suis retrouvé avec une bosse à la place de deux trous rouges au côté droit.
J’avais alors demandé à mon éreinteur le pourquoi de ce machin disgracieux.
- C’est un organe qui s’est déplacé, il s’est étalé pour occuper l’espace…
- Il ne pouvait pas rester à sa place ?
- Eh non, vous savez bien que la nature a horreur du vide !
Mon inquiétude dissipée et ma soif d’information satisfaite, j’ai pris pour argent comptant l’assertion de l’homme de l’art.
L’observation de la marche du monde avait malgré tout instillé le doute quant à ce « la nature a horreur du vide. »
Ce soir, j’ai donné, hélas à mon détriment, la preuve que « la nature a horreur du vide » est une ânerie.
Si c’était vrai, les hommes, surtout moi, n’auraient pas de crâne !
Et pourquoi je vous dis ça, lectrices chéries ?
Si vous lisez les blogueuses de ma listes de favoris, vous savez que Milky a « le cul dans les ronces ».
Et ce parce que sa grand’ mère est hospitalisée.
Et donc, revenons à l’inutilité du crâne puisqu’il n’abrite que le vide dont la Nature a horreur.
Après avoir fait les courses seul – oui ! Tout seul ! – je suis retourné à l’arrêt de bus à côté du Monop’
Après quelques échanges Essèmessiens avec Milky, j’ai donc donné une absence de nouvelles désolante à la lumière de mes jours.
Heure-Bleue m’a demandé alors :
- Mais qu’est-ce qu’elle a ?
- Ben, quatre-vingt-neuf ans, ma Mine…
- Mais c’est pas une maladie, ça !
- Ben si, à partir d’un certain nombre d’années, c’est une maladie…
Mais quel rapport avec « la nature a horreur du vide » ?
Eh bien, quand j’eus arrêté la communication, après avoir glissé le portable dans ma poche, j’ai levé la tête.
Quand je vous dis qu’il y a des têtes dont les cheveux ne servent qu’à n’être pas chauve au lieu de préserver une cervelle des chocs thermiques.
Je n’avais pourtant pas parlé très fort.
Hélas, les oreilles d’une dame de bien plus de quatre-vingts ans étaient trop proches.
Je dois vous avouer qu’à part Heure-Bleue quand j’ai fait une grosse ânerie, personne ne m’avait regardé aussi méchamment que cette dame…
09:36 | Commentaires (7)
samedi, 02 juillet 2016
La vie est un film erratique…

« Chaque âge a ses plaisirs » entends-je seriner régulièrement.
Je veux bien.
Je voudrais seulement qu’on me dise lesquels…
Pour la jeunesse je vois assez bien.
C’est après que ça se gâte…
Pourquoi vous dis-je ça, lectrices chéries ?
D’abord parce que je le pense, ensuite parce que je le vérifie souvent.
Hier par exemple, Heure-Bleue et moi sommes allés traîner à Paris, comme souvent.
Le temps plus vieux a fait des siennes dès notre montée dans le bus.
Un vieille petite fille d’au moins soixante dix ans a fait des siennes.
Je n’ose pas raconter ce qu’elle a dit au cours de la brève conversation décousue qu’elle a eue avec Heure-Bleue.
Elle vous racontera ça mieux que moi…
Après notre döner chez les Turcs de la rue des Petites Écuries, elle et moi avons changé de circuit de pèlerinage.
Nous en avons une grande réserve et nous piochons dedans en fonction de divers critères.
De quoi voulons nous déjeuner.
De quoi voulons nous dîner.
De quoi voulons nous rêver.
De quoi voulons nous nous souvenir.
De quoi voulons nous parler.
Pour le dernier, nous n’avons que l’embarras du choix.
De toute façon nous parlons tout le temps, alors…
Cet après-midi là, la lumière de mes jours et moi avancions rue Vivienne.
Nous nous sommes souvenus des mêmes moments.
- Chaque fois qu’on passe rue Vivienne, je pense à toi…
- Hmmm ?
- Je nous revois, moi te suivant et te regardant, ta mini-jupe verte super courte, et tes jambes pâles super longues.
- Celle dont tu disais que c’était plutôt une ceinture un peu longue ?
- Oui, celle là...
- Chaque fois qu’on passe rue Vivienne, Minou, je pense à toi…
- Hmmm ?
- Je nous revois, toi me suivant et t’arrêtant avec moi devant les vitrines. Tu étais plein d’épis et tu me regardais comme un gâteau…
Nous avons commencé à soupirer puis nous sommes partis dans une discussion à propos du café dans lequel nous nous sommes arrêtés et qui avait bien changé depuis le début des années soixante-dix.
- Il y avait un comptoir, là, Minou, et j’y ai mangé les meilleurs croissants que j’aie jamais mangé.
Après un silence, elle a ajouté d’un ton de regret :
- Je n’ai jamais su où ils les achetaient…
Puis nous sommes passés sur le petit marché de la place de la Bourse et j’ai acheté des poireaux et des cerises pour faire un clafoutis à la lumière de mes jours.
Pour les poireaux, j’ai juste eu l’impression qu’on les avait fait pousser au Parc Monceau et que je venais d’acheter en même temps six ares du parc…
Mais quand même, ce fut une longue et délicieuse promenade que nous avons finie place de la Madeleine.
C’est dans le bus que j’ai appris de la lumière de mes jours, qui n’avait pourtant pas bu que les cerises qu’elle préférait c’est « les bigorneaux ».
Des cerises à coquille dure, en somme, ça nous a fait rire jusqu’à la Porte Champerret.
09:04 | Commentaires (12)
mercredi, 29 juin 2016
Recordar, volver, llorar y desear…
La journée d’hier fut vraiment une journée délicieuse.
Du moins pour nous. L’actualité semble moins enthousiaste sur le sujet…
Nous étions partis pour déjeuner d’un « bô-bun » avant d’aller au cinéma.
Le « bô-bun » de la rue des Dames, puis le café au Wepler et enfin voir « Julieta » au Wepler, le ciné.
Notre balade avait commencé de façon assez sympa dans le train.
Tout en conversant nous promenions le regard sur les voyageurs.
Sur la banquette devant nous un couple.
Deux jeunes gens, une brune de type espagnol et un châtain « genre j’ai trop chaud ».
Quand elle ne lui passait pas la main sur la joue elle le tenait par le cou, ne le lâchait que pour lui embrasser le cou et ne décollait ses lèvres que pour se coller un peu plus contre lui et lui passer le bras autour des épaule.
Le jeune homme devait avoir l’impression de voyager avec une pieuvre.
Nous papotions, Heure-Bleue et moi quand je lui ai dit :
- Tu as vu ça ? Elle ne le laisse pas respirer !
- Oui, j’ai vu. Finalement elle est comme toi, c’est un truc de brun ça…
- Ah, j’étais comme ça ?
- Oui, oui…
- Quand même pas !
- Pire même, Minou…
Bon, maintenant on fait plus ça.
Il faut bien avouer qu’à nos âges ça fait moins joli qu’à vingt ans et quelques…
Heure-Bleue a voulu changer de route pour rejoindre « Pho 9 ».
J’ai dû insister car la lumière de mes jours tenait absolument à partir dans la direction opposée en prétendant que ce serait plus court.
À 40.000 kilomètres près, c’était vrai.
Elle a néanmoins choisi un chemin montant, pas sablonneux mais malaisé pour nous mener à ce « bô-bun ».
Depuis la terrasse du Wepler où nous prenions un café, nous regardions passer les passants…
Heure-Bleue me disait de temps à autre :
- Tu as vu celle-là, celle aux cheveux longs ? Je suis bête, bien sûr que tu l’as vue…
Cela dit, tout fout le camp.
Le tabac de voyous sur la place n’a gardé que le coin tabac et le reste de ce grand café est devenu un « Starbucks » tandis qu’à côte de « Charlot Le Roi des Coquillages » a fleuri un « McDo ».
Même « La Taverne du Régent » a disparu qui accueillit des générations de gamins attendant les gamines qui sortaient du lycée Jules Ferry.
L’heure venue nous sommes allés au cinéma.
« Julieta » nous a passionné.
C’est un des plus chouette film sur le manque, tous les manques et sur l’absence, que j’aie jamais vu.
Même si un point a à mon sens a été une « hypertrophie symbolique », ce film mérite d’être vu.
Même revu.
Le castillan est vraiment une belle langue…
09:39 | Commentaires (11)


